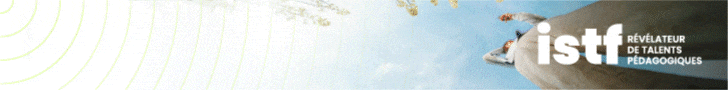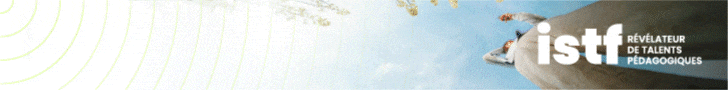|
L’usage généralisé des outils génératifs ne modernise pas le travail : il révèle qu'un effondrement intellectuel menace… Le discernement, cette compétence qui distingue une pensée construite d’un simple enchaînement probabiliste de mots (ce qui est, somme toute, le mode de fonctionnement des IA génératives actuelles), disparaît à mesure que les prompts prennent la place de la réflexion. L’entreprise ne manque pas de technologie ; manquera-t-elle bientôt de jugement ?
 Le prompt paresseux : aveu d’abandon
Le prompt est devenu la nouvelle unité de mesure de l’intention professionnelle. Or ce que l’on lit chaque jour suffit à comprendre l’ampleur du problème. Des demandes floues, sans contexte, sans hiérarchie, écrites à la seconde, souvent copiées-collées. On ne formule plus : on délègue. On ne pense plus : on espère (l'espoir, passion triste, selon Spinoza, car souvent déçu). Les collaborateurs s’en remettent à la machine comme on confierait un dossier à quelqu’un dont on ne se soucie même plus de la compétence. Ce renoncement, devenu routine, ne dit rien de l’IA. Au contraire, il dit tout de la baisse de précision mentale que l’outil expose sans filtre. Le prompt paresseux n’est pas une maladresse ; c’est un abandon.
L'alibi de la vitesse
On le sait de longue date : l’immédiateté a pris le pouvoir. L'IA générative accélère la tendance. Si le texte arrive vite, il passe. S’il est bien tourné, il convainc. La vérification, l’analyse, la contradiction ne sont plus considérées comme du travail, mais comme des retards, des obstacles à une fluidité rêvée. L’outil accélère tout ; le risque, c'est que plus rien ne soit interrogé. Le jugement professionnel s’effrite dans cette précipitation permanente. On accepte des réponses que personne ne prend le temps d’évaluer. L’apparence fait office de fond. Le rythme remplace la rigueur. La vitesse n’est plus un avantage ; c’est un alibi pour ne plus exercer sa responsabilité intellectuelle. Et l'on n'oubliera pas que la gravité d'une catastrophe croit avec sa vitesse (une charette versant dans un fossé versus le crash d'un avion) ! Catastrophes en germe dans l'usage intempestif et hors contrôle de l'IA générative ? On le saura bien assez tôt.
Le nouvel horizon de la pensée standardisée
L’uniformisation n’est plus un risque théorique : elle se constate chaque jour. Les textes se ressemblent, les raisonnements se répètent, les idées s’aplatissent. Ce n’est pas l’outil qui standardise : c’est l’utilisateur qui n’imprime plus rien de personnel dans ce qu’il demande. Les productions deviennent interchangeables parce que les intentions le sont déjà. Les organisations glissent vers une pensée moyenne, sans relief, sans contradiction, sans choix réel. Le discernement n’a plus d’espace dans un environnement où tout se ressemble et personne ne s’en inquiète. Cette tendance de fond n'a pas attendu l'IA générative (on lira avec profit les aventures hilarantes de Dan Lyons, dans le monde du "content marketing"), bien sûr, mais celle-ci la démultiplie dans des proportions jamais vues.
Réintroduire le discernement : un travail de longue haleine
Le discernement n’est pas une qualité abstraite. C’est une discipline : distinguer l’essentiel de l’accessoire, le solide du séduisant, le raisonnable du rapide. Cette discipline n’est plus pratiquée. Elle n’est plus exigée. Elle n’est plus enseignée. On forme aux outils, jamais au jugement. Les collaborateurs savent produire, reformuler, résumer. Ils savent livrer. Mais trop peu savent décider. Le rôle de la formation n’est plus d’ajouter une compétence : il est de restaurer une colonne vertébrale. Recréer l’habitude de vérifier. Retrouver la précision dans la formulation. Réhabituer les équipes à penser avant de demander. Sans cette reconstruction, les outils continueront d’amplifier la confusion au lieu d’accompagner le travail.
Une machine pour rappeler comment raisonner ?!
L’ironie est brutale : l’outil qui accélère la perte de discernement est aussi celui qui la rend visible. Une demande floue produit une réponse floue. Une intention fragile produit un texte fragile. L’IA ne pense pas, et c’est précisément pour cela qu’elle force l’humain à penser mieux. Elle renvoie exactement ce qu’on lui donne : c’est son défaut, c’est aussi sa vertu. Utilisée consciemment, elle devient un révélateur immédiat des imprécisions que l’on croyait indolores. Elle ne rendra pas le discernement. Elle le réclame. Chaque prompt mal ficelé le prouve. La seule vraie question n’est donc pas de savoir si l’outil peut aider. Elle est de savoir si les professionnels accepteront de regarder ce qu’il montre de leur manière actuelle de penser.
Par Michel Diaz
|