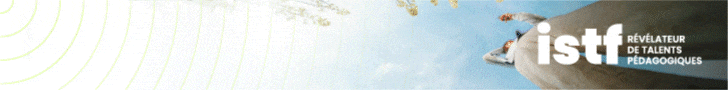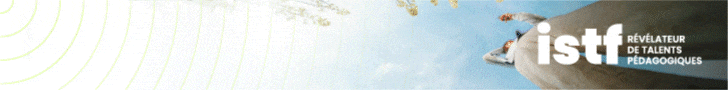|
Quarante ans après "L’ère du vide", le maître-livre de Gilles Lipovetski, l’entreprise vit une mutation d’une autre nature mais d’une même essence : un travail saturé de productions automatiques et appauvri de sens. L’intelligence artificielle ne crée pas ce vide, elle le systématise. À force de confondre vitesse et valeur, la performance devient un mirage : on produit plus, mais on comprend moins. L'urgence : restaurer la substance du travail humain plutôt que de se concentrer sur la seule régulation de la technologie.
 De la vitesse à la vacuité
L’entreprise moderne s’est construite sur un modèle d’efficacité linéaire : faire plus, plus vite, à moindre coût. L’IA générative pousse cette logique à son point extrême. En quelques secondes, elle transforme un brief en rapport, une idée en présentation, un script en vidéo. Les équipes produisent désormais des volumes de livrables qu’aucun humain ne lirait entièrement. Le paradoxe est total : la machine fluidifie tout, mais cette fluidité efface la profondeur. Ce que Lipovetski appelait la “culture du vide” — une société d’images sans ancrage — trouve ici sa version professionnelle : un monde de contenus sans pensée. L’IA n’accélère pas le progrès, elle accélère la superficialité si l’on ne prend pas soin d’en maîtriser le sens. L’illusion de performance repose sur des indicateurs trompeurs : nombre de documents produits, minutes économisées, taux d’utilisation des outils. Tout semble aller plus vite, mais rien ne va plus loin. La productivité devient un spectacle, et l’engagement s’étiole.
Le métier avant la machine
L’entreprise qui croit pouvoir "automatiser le sens" commet une erreur de fond : elle oublie que la compétence ne réside pas dans la production, mais dans l’interprétation. L’IA sait exécuter, elle ne sait pas comprendre. C’est au niveau du terrain que se joue désormais la différence entre valeur et vacuité. Là où la machine reproduit, le professionnel, lui, observe, analyse, ajuste. Le savoir utile ne se trouve pas dans les données, mais dans le geste. Revenir aux fondamentaux du métier, c’est refuser de déléguer à l’IA ce qu’elle ne saura jamais faire : décider avec discernement. Ce retour au concret n’est pas une nostalgie, c’est une urgence stratégique. Dans la banque, l’industrie, la formation, le commerce, les mêmes signaux faibles apparaissent : les organisations les plus performantes sont celles qui parviennent à reconnecter leurs collaborateurs au réel, à redonner au travail une densité vécue. L’IA peut libérer du temps, à condition qu’on sache à quoi le consacrer. Ce temps gagné n’a de valeur que s’il est réinvesti dans la relation, l’analyse, l’innovation, bref, dans tout ce que la machine ne peut pas simuler.
Repenser la mesure de la performance
La culture du chiffre a longtemps servi de boussole à la performance. Mais dans le flux des livrables automatiques, la boussole s’affole. Il ne s’agit plus de compter… mais de comprendre ce qu’on mesure ! L’entreprise doit redéfinir ses indicateurs : non pas combien de contenus ont été produits, mais combien de décisions se sont améliorées ; non pas combien de minutes ont été gagnées, mais combien de compétences ont été renforcées. La productivité devient intelligente lorsqu’elle se met au service du développement collectif. Les directions RH et formation jouent ici un rôle clé : elles seules peuvent réintroduire des critères qualitatifs là où la technologie tend à tout quantifier. Ce changement de métrique est culturel avant d’être technique. Il exige de retrouver le sens du temps long, de la réflexion partagée, du retour d’expérience. C’est aussi le moyen de réhabiliter le management de proximité, celui qui relie les chiffres à la réalité du travail. Mesurer la performance autrement, c’est reconnaître que la vitesse ne suffit plus à qualifier la réussite d’une équipe. On ne pilote pas une organisation avec des tableaux de bord pleins et des cerveaux vides.
Former à lire la machine
Dans ce nouvel environnement saturé de textes, d’images et d’idées générés, la compétence la plus stratégique devient la lecture critique. Non pas lire au sens scolaire, mais lire au sens de déchiffrer : discerner le vrai du vraisemblable, l’utile du superficiel. De l'intérêt, pour les entreprises, d'organiser des sessions où les collaborateurs confrontent les productions d’IA à leur expertise métier… Ces revues critiques sont autant de moments d’apprentissage collectif : elles révèlent ce que la machine ignore, elles restaurent la responsabilité du jugement. Former à l’usage de l’IA n’a de sens que si l’on forme simultanément à la lecture de ses productions. C’est une littératie nouvelle, à la fois cognitive et éthique. Elle suppose de replacer la pensée humaine au centre du processus : la machine rédige, mais l’humain décide de la valeur. Pour les responsables formation-RH, c’est un champ immense : concevoir des dispositifs qui développent le discernement, pas seulement la compétence technique. Car l’enjeu dépasse la maîtrise des outils. Il s’agit de préserver la capacité de l’entreprise à penser par elle-même, à éviter que la production de sens ne soit elle aussi externalisée.
L’ère du vide décrite par Lipovetski était un avertissement culturel. L’IA lui donne une réalité organisationnelle. La substance du travail disparaît à mesure qu'il s'automatise, s'instrumentalise, s'accélère. Mais cette vacuité n’est pas une fatalité. Elle peut devenir un levier, un révélateur. En remettant la mesure, la formation et le métier au cœur de la performance, les directions RH peuvent transformer la vitesse en intelligence, et la technologie en apprentissage. L’IA ne doit pas être l’ennemie du sens, mais son test permanent. Elle nous oblige à redéfinir ce qui mérite encore d’être pensé, appris, transmis. Et c’est là que tout commence.
|